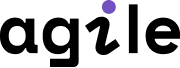Réinsertion professionnelle avec l’AI – témoignage d’une personne avec autisme
Contenu
Autisme et job: entre masque social et épuisement intérieur
«Après mon diagnostic d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) suivi de quelques arrêts maladie, ma vie professionnelle a pris un tournant inattendu. Bien que mon parcours professionnel ait été relativement réussi, j’avais déjà vécu les affres du burn-out et des arrêts maladie sporadiques. Épuisée mais perfectionniste, j’acceptais des postes de plus en plus exigeants, cachant mon état sous une façade de compétence inébranlable. Chaque tâche était un défi, chaque réussite un camouflet à mon propre bien-être.
Même une fois le diagnostic posé, je me suis accrochée à mon mantra: «Quand on veut, on peut.» Pourtant, mes forces m’avaient quittée depuis longtemps. J’ai ignoré les signaux d’alerte envoyés par mon corps, ainsi que les avertissements de mon psychiatre. Le jour de l’expertise AI, je portais encore mon masque social: fonctionnelle, maitrisée, apparemment résiliente. J’ai fait semblant d’aller bien, de pouvoir tenir le coup, alors qu’en réalité, j’étais déjà bien au-delà de mes limites.
Suggestions d’amélioration pour l’expertise AI
L’Assurance-invalidité (AI) joue un rôle crucial dans le soutien et la réinsertion des personnes avec des TSA et autres neurodivergences. Toutefois, le processus actuel d’évaluation et de réadaptation présente d’importantes lacunes. Celles-ci nuisent non seulement à l’efficacité des mesures proposées, mais sapent également la confiance des personnes concernées. Forte de mon expérience personnelle et de mes observations de terrain, je souhaite formuler des propositions concrètes pour renforcer l’expertise au sein de l’AI et améliorer l’accompagnement des personnes concernées:
1. Renforcer les connaissances et la compréhension des TSA
Les expert-es de l’AI doivent approfondir leur compréhension des TSA et des mécanismes de camouflage utilisés par les personnes atteintes de ce trouble. Un meilleur discernement des subtilités permettrait de saisir pleinement son impact et d’adapter les interventions en conséquence.
2. Mener des entretiens approfondis
Lors des évaluations, les expert-es doivent poser des questions approfondies, même si elles peuvent sembler dérangeantes. Cela permet de cerner précisément l’état de la personne évaluée, notamment lorsqu’elle est confuse ou incapable de communiquer clairement ses ressentis. Cette approche peut révéler des aspects cachés essentiels à une évaluation précise.
3. Travailler en étroite collaboration avec le/la thérapeute principal-e
Pour garantir une évaluation fondée et fidèle à la réalité, il est essentiel d’impliquer activement les spécialistes qui suivent la personne concernée – qu’il s’agisse du médecin de famille, d’un-e thérapeute ou d’un-e autre professionnel-le de référence. Ces personnes disposent d’une connaissance approfondie du quotidien, des limitations, mais aussi des progrès réalisés. Une collaboration étroite avec ces expert-es permet d’éviter des décisions basées sur des observations ponctuelles, et favorise une compréhension globale et nuancée de la situation individuelle.
4. Prévenir les mesures hâtives et inappropriées
Les mesures de réinsertion professionnelle devraient être mises en place après une évaluation approfondie et un traitement adéquat. Des interventions précipitées et inadaptées peuvent non seulement être inefficaces, mais aussi, dans le pire des cas, causer des dommages supplémentaires. Une approche intégrée permet de ne pas maintenir coûte que coûte la capacité de travail sans stabiliser l’état de la personne. Or, ce n’est qu’en stabilisant qu’on favorise un rétablissement durable.
5. Revoir les procédures et les pratiques sur la base d’une approche personnalisée et transparente
Chaque personne est unique et mérite d’être traitée comme telle. Les procédures standardisées, souvent trop brèves, ne tiennent pas toujours compte des besoins spécifiques des personnes assurées. L’AI gagnerait à adopter une approche plus individualisée et transparente, fondée sur une analyse approfondie de chaque situation. Cela permettrait de concevoir des mesures véritablement adaptées, renforçant ainsi l’efficacité du soutien tout en assurant une utilisation plus ciblée et efficiente des ressources.
Retour à la vie professionnelle grâce à l'AI – comment réussir la réinsertion des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme
Améliorer le fonctionnement de l’AI, en particulier dans les cas complexes comme ceux liés à l’autisme, passe par une approche individualisée, respectueuse et collaborative. En impliquant les thérapeutes, en posant les bonnes questions, et en adaptant les interventions, l’AI pourrait offrir un accompagnement plus humain et plus efficace.
Les bilans de compétences, les mesures de coaching et de réinsertion doivent tenir compte des recommandations des thérapeutes référent-es, et s’appuyer sur un processus sécurisé, avec des rendez-vous réguliers et des échanges constants. L’octroi rapide d’une rente AI pourrait aussi apporter une stabilité financière précieuse, condition essentielle pour un rétablissement durable et une réintégration progressive dans le monde professionnel.
Une telle approche favoriserait non seulement un retour plus rapide à l’équilibre personnel, mais aussi une meilleure reconnaissance et validation du vécu des personnes assurées. Un accompagnement empathique, fondé sur la compréhension et le respect, est la clé d’une réinsertion réussie.»
Conclusion: un accompagnement individuel et une meilleure connaissance des TSA auprès de l'office AI sont les clés d'une réinsertion réussie
L’AI peut jouer un rôle important dans la réinsertion professionnelle des personnes autistes – à condition que l’accompagnement soit individuel, professionnel et respectueux. Mon témoignage montre qu’il existe encore un potentiel d’amélioration considérable dans la pratique. Une plus grande implication des professionnel-les, une meilleure connaissance des TSA et une approche plus flexible pourraient augmenter considérablement l’efficacité des mesures.»
* Nom connu de la rédaction
En savoir plus sur les obstacles aux prestations sociales
- Link zur DetailseiteCommuniqué de presse
Prestations sociales: Agile révèle des lacunes alarmantes
En Suisse, un grand nombre de personnes en situation de handicap renoncent aux prestations sociales auxquelles elles ont pourtant légalement droit. Agile révèle les obstacles systémiques qui entravent ou compliquent l’accès aux prestations, et ce qu’il faut changer. - Link zur DetailseiteConnaissance spécialisée
Obstacles aux prestations sociales et handicap: comprendre leurs causes et leurs effet
De nombreuses personnes en situation de handicap renoncent à des prestations sociales. Pourquoi? Quelles conséquences? Cet article fait le point. - Link zur DetailseiteConnaissance spécialisée
Améliorer l’accès aux prestations sociales: Les personnes avec handicap témoignent
Le conseil par les pair-es permet de supprimer les barrières aux prestations sociales. Un office AI et des conseillers partagent leurs expériences et des bonnes pratiques. - Link zur DetailseiteConnaissance spécialisée
Supprimer les barrières aux prestations sociales grâce au conseil par les pair-es
Le conseil par les pair-es permet de supprimer les barrières aux prestations sociales. Un office AI et des conseillers partagent leurs expériences et des bonnes pratiques. - Link zur DetailseiteConnaissance spécialisée
Services publics sans barrière: Un guide pratique – Bientôt disponible
Le conseil par les pair-es permet de supprimer les barrières aux prestations sociales. Un office AI et des conseillers partagent leurs expériences et des bonnes pratiques. - Link zur DetailseiteArticle
Rapport (Non-)recours aux prestations sociales, janvier 2024
Résultats d’une enquête auprès de personnes en situation de handicap sur les obstacles à l’obtention des prestations sociales